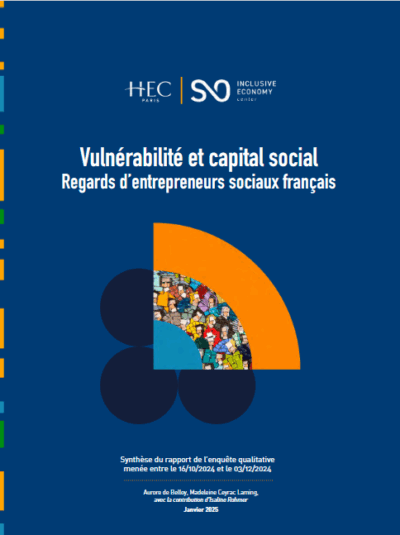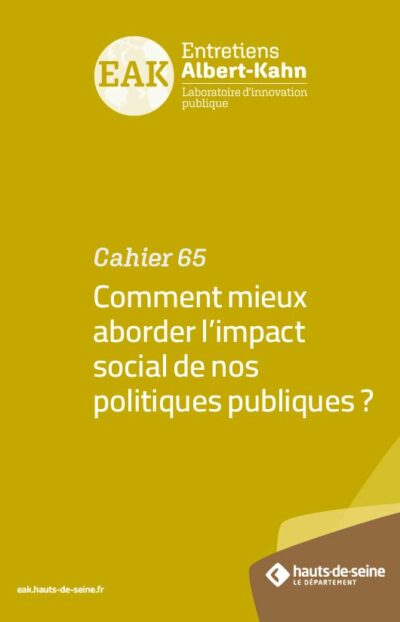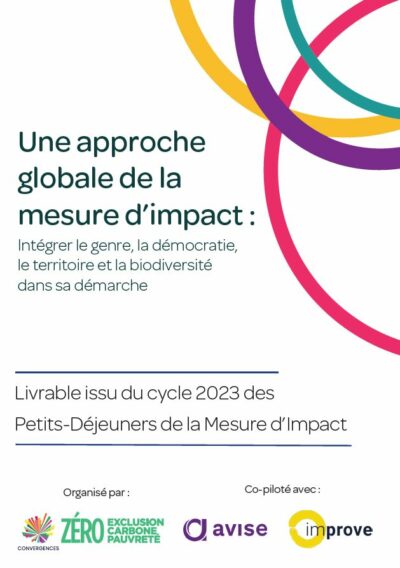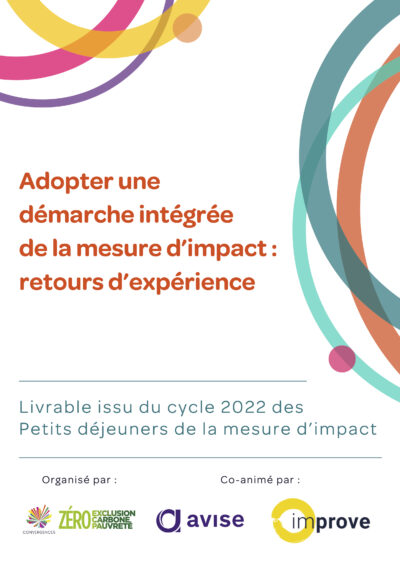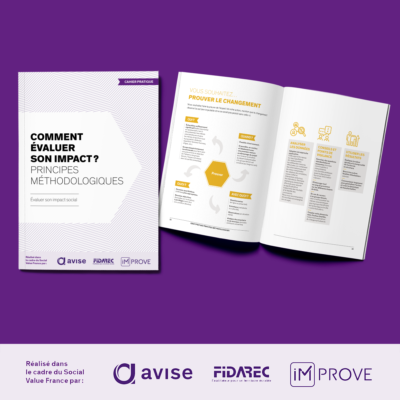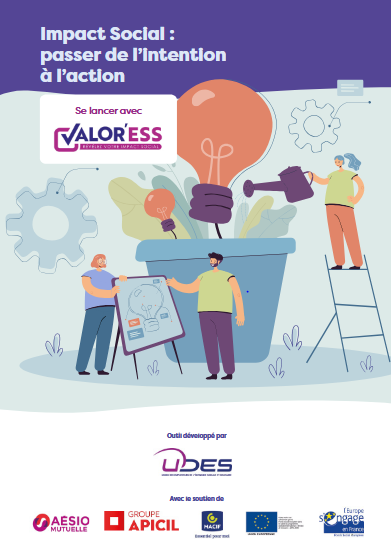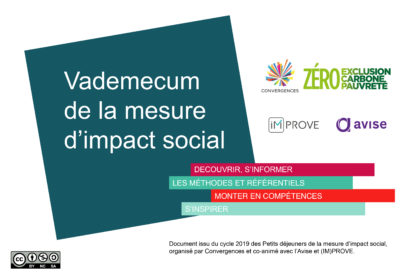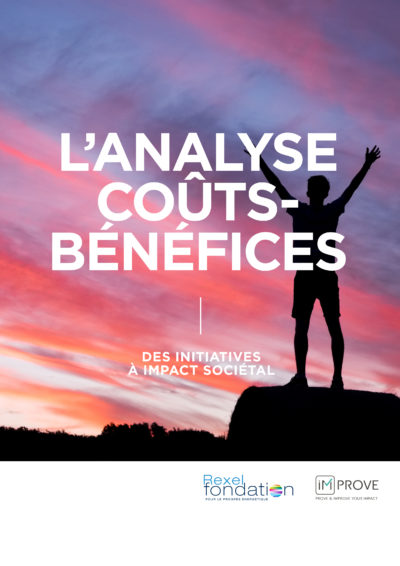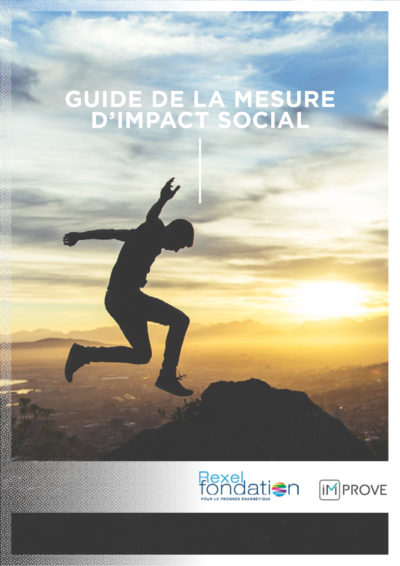Plus de la moitié des acteurs de l’économie sociale et solidaire (56,2%) considèrent le coût comme l’un des principaux freins à mener une évaluation d’impact[1]. Cette difficulté de financement met en avant le besoin de trouver de nouvelles sources de financement. Dans le domaine de l’évaluation d’impact, on recense un certain nombre d’acteurs en capacité d’accompagner les structures à différents niveaux[2]. Parmi ces acteurs, certains sont spécialisés dans l’accompagnement financier. Cet article vient en complément de la littérature existante sur le sujet des financements en évaluation d’impact.
1/ Comment ma structure peut-elle s’autofinancer ?
Une des solutions d’autofinancement la plus courante pour une évaluation d’impact est celle qui se réalise à partir des fonds propres de sa structure. C’est le cas pour 77% des acteurs de l’économie sociale et solidaire[3] (ESS).
Conseil pour les petits budgets : vous pouvez prioriser sur certaines parties de votre évaluation d’impact afin de vous concentrer sur le périmètre le plus essentiel. Par exemple, vous pouvez choisir l’étude d’une seule partie prenante plutôt que celle de plusieurs parties prenantes.
Une autre possibilité d’autofinancement est de réaliser tout ou partie de votre évaluation d’impact en interne. Si les moyens financiers de votre structure ne vous permettent pas de recourir à un cabinet de conseil (à une externalisation), l’internalisation[4], partielle ou totale, s’avère une option intéressante.
Conseil : n’hésitez pas à anticiper votre évaluation d’impact ! Cela vous permettra de déterminer une enveloppe budgétaire adéquate selon vos besoins et enjeux et de prévoir des temps dédiés.
2/ Ma structure peut-elle impliquer ses financeurs existants ?
Si votre structure perçoit des financements de la part de financeurs externes, il est possible de leur demander une participation pour la réalisation d’une évaluation d’impact. Aussi, n’hésitez pas à inclure les financeurs dans votre démarche d’évaluation d’impact. Par exemple en les faisant participer à diverses étapes comme les COPIL, les entretiens exploratoires, etc. L’intérêt pour les financeurs est de leur garantir une transparence dans le partenariat qui les lie à votre structure. De plus, en tenant compte des besoins des financeurs et en les incluant dans l’évaluation d’impact, vous êtes à même de pouvoir communiquer et valoriser des résultats finaux les concernant.
À l’attention des financeurs : en tant que financeurs vous pouvez décider, avant l’arrêt de vos financements, de financer une évaluation d’impact. Cela permet à la structure soutenue de trouver d’autres sources de financement.
3/ Vers quels autres acteurs ma structure peut-elle se tourner ?
Si votre structure ne dispose pas de fonds suffisants pour s’autofinancer ni de soutiens financiers externes, elle peut se tourner vers d’autres financeurs. Il existe de nombreux acteurs en capacité de financer tout ou partie d’une évaluation d’impact. En voici quelques exemples :
Les dispositifs locaux d’accompagnement (DLA), permettant de se former sur différentes étapes de son parcours en fonction de ses besoins ;
Les fondations[6], qui soutiennent de nombreux porteurs de projets et souhaitent s’assurer du bon usage de leurs financements. Au-delà du soutien financier, certaines fondations vont plus loin et proposent un accompagnement plus complet dans la réalisation et l’évaluation de l’impact social de leurs partenaires. C’est le cas par exemple de la Fondation AESIO, qui propose à ses partenaires une formation et des sessions de coaching en partenariat avec notre cabinet Improve ;
Les appels à projets, qui accompagnent et soutiennent financièrement des porteurs de projets à impact. Ils sont lancés par différents groupes comme l’Agence Française de Développement ou encore le Fonds Social Européen + [7]porté par l’Avise;
Le contrat à impact social (CIS), qui est un outil de financement innovant pour des projets de grande ampleur. Il permet de financer l’action d’un porteur de projet pour un besoin identifié mais également une évaluation d’impact social.
À l’attention des financeurs : pour un appel à projet, il est intéressant d’inclure dans le cahier des charges [8] une enveloppe budgétaire pour une évaluation d’impact. Cela permet d’attirer des structures étant dans une démarche d’amélioration continue de leur impact et souhaitant privilégier les échanges partenariaux.
4/ Quels partenariats ma structure peut-elle envisager ?
Différentes formes de partenariats sont possibles pour mener à bien une évaluation d’impact et, ce, à moindre coût.
Ce peut être, par exemple, la création d’un poste de doctorat Cifre (Convention industrielle de formation pour la recherche), associant à la fois la structure, le laboratoire de recherche universitaire et le doctorant. En confiant un travail de recherche à un doctorant, la structure s’assure une ressource humaine supplémentaire qualifiée et optimise le temps consacré à la recherche et développement (R&D).
Il peut également être question d’une coopération directe avec une université. Dans un intérêt commun, de plus en plus de structures collaborent avec des universités dans une démarche de co-formation permettant également aux professionnels de participer de près au travail d’évaluation [9].
Aussi, il est possible qu’un partenariat se fasse uniquement pour certaines étapes de l’évaluation d’impact. Par exemple, créer un partenariat avec des chercheurs souhaitant collecter des données de terrain sur le public de la structure. Dans ce cas, seule l’étape de la collecte et du traitement des données est concernée.
Pour citer cet article : Improve, Financer son évaluation d’impact : comment faire ?, janvier 2025
[1] Baromètre de la mesure d’impact social, KPMG, 2017
[2] Pour en savoir plus sur les acteurs du domaine de l’EIS : Avise, Me faire accompagner et financer pour évaluer mon impact, 2023
[3] Baromètre de la mesure d’impact, KPMG, 2017
[4] Pour en savoir plus sur l’internalisation et l’externalisation : Improve, Internaliser ou externaliser une évaluation, comment choisir, octobre 2022
[5] Pour en savoir plus sur la formation-action : Agence Lucie, Comprendre les fondamentaux de l’évaluation d’impact social
[6] Pour en savoir plus sur les accompagnateurs : Improve, Fondations, réseaux, fonds de dotation : comment évaluer son impact en tant qu’accompagnateur ?, mai 2024
[7] Pour en savoir plus sur le FSE+ : Avise, Financer l’ESS, 2023
[8] Pour en savoir plus sur le cahier des charges en évaluation d’impact : Improve, Le cahier des charges en évaluation d’impact : pour bien faire il faut bien commencer, octobre 2022
[9] N. Bartkowiak et al. Récit d’un partenariat institution-université pour produire des connaissances partagées. Dans le Sociographe 2018/4 ( n°64), pages 1 à 12.